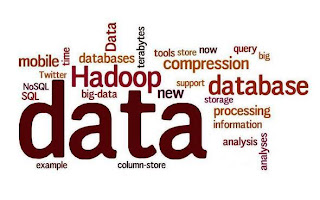Bon on parle de quoi pendant un pitch ? De but en blanc, le concept de prise de parole et l’art de la rhétorique doivent prendre l’ascendant sur la dimension fonctionnelle, technique et technologique du produit. On obéit à un triptyque argumentaire : vous posez un problème, votre équipe est la mieux à même de le résoudre, le tout englobé dans une perspective de marché prometteur (le pitch étant souvent par essence adressé à une communauté d’investisseurs, de VC, de prospects). Vous n’avez pas eu le temps de faire l’apologie de vos milliers de lignes de codes disruptives ? Que votre mathématique algorithmique que vous avez développée en mode "techos-garage" avec vos associés pendant 2 ans vont clairement marquer une rupture de paradigme ? Ce n’est ni lieu, ni l’endroit de l'évoquer. L’enveloppe fonctionnelle et la dimension technique seront évoquées par la suite si votre interlocuteur vous glisse d’un air facétieux « I wanna know more about that, let’s schedule a meeting ». Exercice périlleux : ne pas chercher à distiller un maximum d’informations (seulement les plus percutantes), esquisser un business novateur à forte dimension exploratoire avec un business model cohérent et éprouvé (value proposition).
Pourquoi, nous français, galérons sur le pitch ?
Alors pour quelles raisons, on affecte communément le pitch à un choc inter-culturel périlleux plutôt qu’à un apprentissage de communication salutaire comme une autre ? Pourquoi, nous, gaulois, galérons autant à maîtriser cette composante de vocalise ? Les raisons du mal sont plus préoccupantes. Elles renvoient à l’opposition binaire entre l’entrepreneur français, à grosse dominante de communication technophile, face à l’américain maitrisant les lettres de noblesse de l’expression orale concise depuis son plus jeune âge. Sur ce coup-là, on est des vecteurs passifs du holisme éducatif. Notre système éducatif archaïque n’a jamais privilégié le story-telling et le marketing verbal percutant. L’art de l’exposé est redouté et relégué à l’école. La philosophie de notre système éducatif s’accroche à des bases (malheureusement inébranlables
 à ce jour) désuètes et vétustes. Elles consistent à rivaliser entre apôtres de l’éducation à celui qui arrivera à faire copier le plus ses élèves sur une logique de volume. A formater ses élèves. Les convaincre que la connaissance est payante, statique, qu’elle se recopie, se duplique et qu’elle doit être gravée dans le marbre à coup de burin. Un véritable processus itératif à mesure que les classes et promotions se succèdent. Imbriquée dans une réflexion plus globale sur l’éducation, l’impétueux Gilles Babinet, appelle ça « l'avènement du taylorisme et de l’ère industrielle du système éducatif », qu’il appelle de ses veux à se régénérer et se remettre en cause le plus rapidement. Pas faux. Le discours académique se confine et se complait dans l’obscurantisme et le déni à se réformer. Le mammouth a les oreilles qui sifflent face à ces doléances. Malheureusement, il fait la sourde oreille.
à ce jour) désuètes et vétustes. Elles consistent à rivaliser entre apôtres de l’éducation à celui qui arrivera à faire copier le plus ses élèves sur une logique de volume. A formater ses élèves. Les convaincre que la connaissance est payante, statique, qu’elle se recopie, se duplique et qu’elle doit être gravée dans le marbre à coup de burin. Un véritable processus itératif à mesure que les classes et promotions se succèdent. Imbriquée dans une réflexion plus globale sur l’éducation, l’impétueux Gilles Babinet, appelle ça « l'avènement du taylorisme et de l’ère industrielle du système éducatif », qu’il appelle de ses veux à se régénérer et se remettre en cause le plus rapidement. Pas faux. Le discours académique se confine et se complait dans l’obscurantisme et le déni à se réformer. Le mammouth a les oreilles qui sifflent face à ces doléances. Malheureusement, il fait la sourde oreille.

Mais y’a pas que ça : le français n’aime pas le marketing
On relève trop fréquemment des entrepreneurs se perdant dans le dédale des fioritures techniques et la nébuleuse fonctionnelle du produit qu’il propose. Le problème de ce qu’il cherche à résoudre et l’équation n’ont pas été posés, que x et y sont déjà détaillés. L’argumentation s’en retrouve déstructurée, la clarification édulcorée. Comme le précise, Benjamin Pelletier, expert de l’interculturel : il y a de la part des français "des difficultés à passer de la production, autrement dit du savoir-faire au faire-savoir. L'efficacité technologique du produit n'implique pas forcément l'efficacité discursive. Or, les entrepreneurs ont tendance à considérer que ce deuxième aspect propre au marketing n'est qu'une enveloppe extérieure et secondaire, une sorte d'emballage par les mots et les arguments. négliger la dimension informative revient à tronquer le produit.
Le Français suppose que l’empathie avec son produit entraînera une empathie identique chez son interlocuteur". Alors que le focus doit être axé sur le problème et les attentes de son interlocuteur, qui, bien souvent ne relève pas de la même profession. Donc vulgarisez. Soyez acrobate : alliez le pragmatisme business et la dominante humaine et émotionnelle. Car pour tout entrepreneur, il s'agit aux US d'un commandement incontournable : maîtriser à la pointe le précepte du pitch. Le poujadisme artistique français n'a pas sa place sur ce pan. Ainsi, le technophile français érudit rejette bien souvent cette science et les ressorts du marketing. Il privilégie la primauté technique et fonctionnelle de son produit pour assoir son auditoire. En France, la dogmatique du marketing est fréquemment étiquetée comme pernicieuse, subsidiaire, creuse, insipide. Peut être car mal enseignée. A contrario, pour un anglo-saxon, la communication verbale et le marketing, de manière plus globale, sont des composantes indissociables de son produit. Elle a ses faveurs dans cette opération délicate d'envoûtement et son entreprise d'évangélisation.
Le Français suppose que l’empathie avec son produit entraînera une empathie identique chez son interlocuteur". Alors que le focus doit être axé sur le problème et les attentes de son interlocuteur, qui, bien souvent ne relève pas de la même profession. Donc vulgarisez. Soyez acrobate : alliez le pragmatisme business et la dominante humaine et émotionnelle. Car pour tout entrepreneur, il s'agit aux US d'un commandement incontournable : maîtriser à la pointe le précepte du pitch. Le poujadisme artistique français n'a pas sa place sur ce pan. Ainsi, le technophile français érudit rejette bien souvent cette science et les ressorts du marketing. Il privilégie la primauté technique et fonctionnelle de son produit pour assoir son auditoire. En France, la dogmatique du marketing est fréquemment étiquetée comme pernicieuse, subsidiaire, creuse, insipide. Peut être car mal enseignée. A contrario, pour un anglo-saxon, la communication verbale et le marketing, de manière plus globale, sont des composantes indissociables de son produit. Elle a ses faveurs dans cette opération délicate d'envoûtement et son entreprise d'évangélisation.
Bon maintenant, qu’on a vilipendé Jules Ferry et ses apôtres. Que faire pendant un pitch ?
Le cadre est millimétré, le show peut commencer. Il faut faire marcher la magie : phrases mémorables, éventuel recours à un support power point affûté, scénarisé d'images. Souplesse d'adaptation, talents de mise en scène, usage de l'anecdote et des allégories permettent de donner des points de repère et des balisages à votre auditoire dès lors que vous évoquez un produit ou procédé que vous jugez disruptif. Improvisation maîtrisée et humour subtile sont également de rigueur. La "user expérience" doit être vivifiante afin que votre interlocuteur puisse se sentir associé et se projeter dans votre aventure. Comme il ne s'agit pas de rédiger un executive summary sur simple feuille A4, mais bien d'orchestrer un exercice tonique, la personnalité et la ténacité du speaker doivent faire la différence.
En effet, l'investisseur ou le prospect seront amenés à mettre un écu sur une start up embryonnaire, un produit certes, mais surtout à parier sur un projet porté par des individus auxquels ils doivent croire. Comme un bon épisode de Mad Men, distillez à bonne dose les phrases catchy, afin de lui donner envie de mater le prochain épisode. Aficionados de Louis la Brocante et Columbo, ne pouvant se défaire du formalisme argumentatif et du besoin de dénouements à chaque fin d'épisode, passez votre chemin.
Vos interlocuteurs apprécieront un balancier et une alchimie particulière : le plus souvent; le concept "sales revenue / business model" doit être éprouvé, tandis que le produit doit avoir une certaine dimension exploratoire. Mais cherchez surtout à introduire de nouvelles "règles de grammaire" : prenez de la hauteur, vous êtes à la tête d'une rupture de paradigme dans votre domaine. Votre solution doit chercher à modifier davantage les règles du jeu de votre écosystème, que vos concurrents ne chercheront à le faire. Là est l'idée sous-jacente de créer son propre jardin et dessiner son propre cadastre. Plutôt que de subir et de devoir planter sa tente dans le jardin de vos "partenaires", sous peine de se faire virer manu-militari sans préavis et sans respect de la trêve hivernale (cf. amère expérience contemporaine du social gaming de Zynga sur Facebook).
En effet, l'investisseur ou le prospect seront amenés à mettre un écu sur une start up embryonnaire, un produit certes, mais surtout à parier sur un projet porté par des individus auxquels ils doivent croire. Comme un bon épisode de Mad Men, distillez à bonne dose les phrases catchy, afin de lui donner envie de mater le prochain épisode. Aficionados de Louis la Brocante et Columbo, ne pouvant se défaire du formalisme argumentatif et du besoin de dénouements à chaque fin d'épisode, passez votre chemin.
Vos interlocuteurs apprécieront un balancier et une alchimie particulière : le plus souvent; le concept "sales revenue / business model" doit être éprouvé, tandis que le produit doit avoir une certaine dimension exploratoire. Mais cherchez surtout à introduire de nouvelles "règles de grammaire" : prenez de la hauteur, vous êtes à la tête d'une rupture de paradigme dans votre domaine. Votre solution doit chercher à modifier davantage les règles du jeu de votre écosystème, que vos concurrents ne chercheront à le faire. Là est l'idée sous-jacente de créer son propre jardin et dessiner son propre cadastre. Plutôt que de subir et de devoir planter sa tente dans le jardin de vos "partenaires", sous peine de se faire virer manu-militari sans préavis et sans respect de la trêve hivernale (cf. amère expérience contemporaine du social gaming de Zynga sur Facebook).
« Houston, we got a problem… a good one”
Je ne touche pas de royalties, mais si vous cherchez à vous exercer au pitch sur Paris, nous collaborons avec la meilleure (au bas mot) prof californienne de coaching dans ce domaine et elle exerce également de temps en temps à la CCI de Paris dans le cadre de nos préparations de missions d'accompagnement de start up aux US organisée par la CCI Paris IDF (Rhannon McMillan, Focus4 Communications).
On parlait d'émotionnel, et pour mon plaisir perso, une séquence assez mythique où comment rendre un produit désuet en trendy en surfant sur la vague du vintage. Merci Don Draper d'illustrer mon propos empirique.